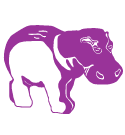Histoire de l'art
Image du sacré, image du profane
Chantal Duquéroux-Rozwens
Conférences avec vidéoprojection
Quels sont les sujets de la peinture ? Quels sont les sujets de l’art ?
On pourrait répondre à l’évidence que la question n’a pas lieu d’être...
Mais dans les époques historiques, les imagiers, ceux qui fabriquaient l’image avaient un devoir sacré, traduire justement le sacré de leur temps.
Souvent leur recherche devait donner à voir ce qui ne se voit pas, ce qui est absolu, éternel, spirituel...
Pour atteindre ce but il n’y avait qu’une possibilité, exprimer par le visible l’histoire invisible, le mystère. Le défi était de taille, et l’histoire de l’art nous offre un catalogue absolument éblouissant de ces grandes créations.
L’image profane existe elle aussi dans le même temps parce que l’une ne va pas sans l’autre. L’une engendre l’autre au cours de l’histoire.
Le profane est temporel, c’est la matière, le terrestre, tout ce que la Renaissance occidentale cherchera à retrouver. Traduire le visible dans toute sa réalité fut la préoccupation majeure de la modernité.
Nous irons voir du coté du Moyen Âge, mais d’abord de Constantinople et de l’icône à la sortie du monde Romain. Comment le profane est devenu sacré, religieux.
Et en nous appuyant entre autres sur les textes de l’historien de l’art Daniel Arasse, nous verrons au XVème et XVIème siècle à Venise et à Rome comment les maîtres dont Giovanni Bellini, Raphaël et Titien ont transcendé les deux images.
Image du sacré, image du profane
Conférences avec vidéoprojection
les mardis de 9h30 à 11h30
3 sessions de 9 séances chacune
1ère session :
2ème session :
3ème session :
Début le 23.09.2025
Début le 06.01.2026
Début le 24.03.2026
Coût de chaque session : 170 € (2x85)
Résonances et dialogue pictural
Pascal Coulon
Conférences avec vidéoprojection
Il s’agira de s’intéresser dans ce cours à la façon dont les œuvres font écho en nous. Par quel mécanismes une œuvre – picturale, musicale, littéraire, théâtrale, dansée – résonne en nous de telle sorte qu’elle « nous parle », ou encore qu’elle ait le pouvoir de nous révéler une vérité enfouie en nous ?
Dans cet ordre d’idées, nous observerons aussi avec un certain nombre d’œuvres et d’auteurs précis ces phénomènes de résonance d’une discipline artistique à une autre, et l’idée qu’une œuvre littéraire féconde une œuvre picturale, etc.
Outre cette dimension interdisciplinaire, nous serons aussi amenés à comprendre pourquoi et comment, à l’intérieur d’un même champ, des artistes travaillent sur la matière des Anciens, la façon dont les peintres modernes, par exemple, se réapproprient des œuvres classiques (Manet, Hopper, Picasso, etc.), la nature des transformations qu’ils impriment aux toiles des Anciens, etc.
Cependant, des éléments d’histoire de l’esthétique nous aideront à comprendre ce qui a permis ces phénomènes d’appropriation, les conditions de possibilité de ces correspondances. C’est en effet l’entrée dans la modernité baudelairienne et la reconnaissance d’une égale dignité de chacun des arts qui a permis que soit dépassée l’hypothèse d’une hiérarchie rigoureuse des arts à l’âge classique – laquelle ne permettait pas l’appréciation de ces correspondances.
Résonances et dialogue pictural
Conférences avec vidéoprojection
11 jeudis de 9h30 à 11h30
début le 02.10.2025
207 € (3x69)
Florence, Avignon et les Flandres au XVe et XVIe siècle :
dialogues entre artistes et prise de conscience culturelle
Jacopo Pasquali
Conférences avec vidéoprojection
Les échanges artistiques qui eurent lieu au XVème et XVIème siècles entre l’Italie, les régions transalpines et l’Europe du Nord sont un sujet de grande importance historique pour reconstituer notre passé commun, dont les répercussions se font sentir jusqu'à aujourd'hui. En effet, bien avant que les politiques européennes contemporaines ne commencent à considérer la culture comme un facteur d’unité, les banquiers et les marchands florentins jouèrent le rôle de véritables médiateurs culturels, en permettant, en parallèle aux échanges pécuniaires et de marchandises, le mouvement des œuvres d’art et avec elles des langages artistiques, des styles et des idées.
À Florence, grâce à l’ouverture d’esprit et à l’intelligence raffinée de cette riche classe marchande, qui faisait des affaires à Bruges aux Pays Bas ainsi qu’à Avignon, on pouvait admirer sur les autels des églises et dans les chapelles privées des hôtels particuliers les tableaux réalisés par Roger van der Weyden et Hans Memling, mais aussi par des peintres qui malheureusement demeurent encore anonymes et énigmatiques, tels que le Maître de la Légende de Sainte-Ursule ou le Maître des Portraits Baroncelli.
Cette admiration inconditionnée et savante pour l’art des pays du Nord qui enflamma en premier lieu les Médicis et les Portinari, influença le goût de la société de l’époque et bien sûr des artistes locaux, et l’importance de cet art du Nord dans le développement de la peinture à Florence est désormais une donnée acquise dans les études d’Histoire de l’Art.
On ne peut absolument pas nier que l’arrivée en 1483 à Florence du Triptyque Portinari peint par Hugo van der Goes et son exposition dans l’église de Saint-Gilles (Sant’Egidio) eut une influence fondamentale dans le parcours d’artistes florentins, tels que Filippino Lippi, Domenico Ghirlandaio et Lorenzi di Credi. Un souvenir de cette œuvre monumentale apparaîtra ensuite, au XVIème siècle, dans certains retables exécutés par Simon des Châlons et son atelier actif à Avignon. À cet égard, il ne faut pas non plus oublier l’arrivée à Florence, vingt ans avant le Triptyque Portinari, en 1461, du Triptyque de Saint- Lazare commandité par l’homme d’église Fausto Coppini à un peintre français nommé Nicolas Froment, originaire de la Picardie, mais qui s’installa très tôt à Avignon, où il devint l’artiste principal de la cour de René d’Anjou et de l’école d’Avignon. On retrouvera des traces de son style expressionniste à Florence chez Domenico Veneziano et Andrea del Castagno, deux importants représentants de la « peiture de lumière ».
Florence, Avignon et les Flandres au XVe et XVIe siècle
Conférences avec vidéoprojection
12 lundis de 14h00 à 16h00
début le 29.09.2025
225 € (3x75)
Traumatisme et création
Pascal Coulon
Conférences avec vidéoprojection
Un certain nombre d’œuvres - de Frida Khalo, Louise Bourgeois, Nicky de Saint Phalle, entre autres – peuvent certainement valoir comme des vecteurs de sublimation d’un traumatisme initial.
Nous serons amenés à mieux comprendre ces phénomènes en entrant dans le détail de l’expression artistique d’auteurs précis, qu’il s’agisse de celles déjà citées, ou de Goya, Dix et bien d’autres.
Mais toute œuvre ne résulte-elle pas d’une faille, existentielle et universelle, que l’artiste transmue en lumière ? De ce point de vue, l’étude de la mélancolie nous fournira un arrière-plan très fécond pour mieux saisir les conditions d’émergence de l’œuvre littéraire, philosophique ou picturale de grands artistes tout au long de l’histoire.
Si la maladie est parfois indissociable de la production artistique, se pourrait-il en retour que l’art ait des pouvoirs thérapeutiques dans certaines conditions ? C’est ce que nous verrons également avec une partie consacrée aux relations de l’art et de la thérapie.
Traumatisme et création
Conférences avec vidéoprojection
11 jeudis de 9h30 à 11h30
début le 15.01.2026
207 € (3x69)
Les Étrusques : art, culture et histoire
Jacopo Pasquali
Conférences avec vidéoprojection
Au-delà de l’aura de mystère qui caractérise les Étrusques et leur langue encore largement incomprise et intraduisible, nous pouvons aujourd’hui découvrir leur histoire fascinante et la richesse de leur civilisation, à mi-chemin entre Orient et Occident, grâce aux plus récentes connaissances de l’archéologie et de la philologie, ainsi qu’à travers l’analyse de la culture figurative dans ses différentes manifestations - architecture, peinture, sculpture, toreutique et arts appliqués.
Ainsi nous allons revenir sur dix siècles de production artisanale et artistique, à partir des premières tombes villanoviennes de l’âge du fer jusqu’aux chefs-d’œuvre d’influence hellénistique à la fin de la République romaine, en passant par les magnificences de la période orientalisante.
Les Étrusques : art, culture et histoire
Conférences avec vidéoprojection
12 lundis de 14h00 à 16h00
début le 19.01.2026
225 € (3x75)
L'Art contemporain au féminin : Une esthétique spécifique ?
Dominique Bernard Faivre
Conférences avec vidéoprojection
L’ art « contemporain » englobe toutes les formes propres aux arts visuels d’aujourd’hui telles, par exemple, que l’installation et la performance dans leur rapport avec l’art minimaliste et/ou conceptuel, comme en attestent le bombage au service de ce dernier avec Miss Tic en 2024, ou l’oscillation entre ornementation et minimalisme des installations d’Eva Jospin en 2023, au Palais des Papes également.
En outre, la matière artistique même semble s’appuyer davantage sur les matériaux « naturels » ou de synthèse, mais aussi le marbre ou le verre soufflé dans des usages actualisés avec, par exemple les œuvres de Dana-Fiona Armour exposées à la collection Lambert en 2022, ou celles de Jean-Michel Othoniel en tête d’affiche cette année au Palais !
Mais c’est sans doute sur le plan des finalités que l’art contemporain au féminin se distingue, évidemment de l’histoire de l’art en général, mais aussi de celui de ses homologues masculins. Car si tous s’accordent à mettre en scène, dans les vanités contemporaines notamment, des motifs relevant de la conscience de la temporalité humaine, des dimensions relatives à la place des femmes sont omniprésentes dans la création féminine, qui peut prendre parfois une couleur politique hautement provocatrice.
Nous serons alors amenés à nous poser des questions à partir d’artistes plasticiennes et de mouvements tels que l’art féministe (Nicky de St Phalle), le pop art (Yahoi Kusama), l’art environnemental (Nancy Holt) et le land art (Juliana Notari), l’art corporel (Gina Pane) et le body art (Orlan), le street art (Shamsia Hassani) et la bad painting (Alice Neel), sans omettre les derniers-nés que constituent par exemple le bio art (Amy Karle) ou l’art digital (Sabrina Ratté, Lucy Macaroni…) impliquant la plus haute technologie…
L'Art contemporain au féminin
Conférences avec vidéoprojection
10 lundis de 14h00 à 16h00
début le 09.02.2026
188 € (2x94)
Le cinéma italien par le prisme de ses vedettes : Marcello Mastroianni et Sophia Loren
Laura Vichi
Conférences avec vidéoprojection
Comme l'affirmait Edgar Morin dans son célèbre Les Stars (1957), « l'histoire des stars recommence à sa mesure l'histoire des dieux », cette fois-ci en relançant par le cinéma une religion faite d'idoles de chair et de sang que l'écran a le pouvoir de magnifier en créant des modèles de comportement, féminité/masculinité, mode... Le rayonnement de la star excède donc autant sa personne que sa profession d'acteur/actrice .
En Italie, le vedettariat se développe dès les années 1910 en créant au fur et à mesure des modèles de masculinité et de féminité qui vont s'imposer et se modifier au fil des époques.
Marcello Mastroianni est découvert par Luchino Visconti et propulsé vers le cinéma par Giulietta Masina à la fin des années 1940. Pendant la décennie suivante il joue surtout le rôle du bon garçon un peu naïf pour devenir, en 1960 la vedette planétaire que tout le monde connaît grâce à La dolce vita de Federico Fellini, dont il va devenir l'acteur fétiche et où il propose une figure de latin lover atypique ou, du moins, contradictoire, qu'il va continuer de travailler et développer par la suite.
Sophia Loren, arrivée au cinéma par un concours de beauté à l'époque des « maggiorate », va progressivement se révéler une actrice à part entière et s'affirmer comme star internationale, même si dans l'imaginaire collectif elle reste en grande partie liée au nom de Vittorio De Sica et aux personnages de la belle fille du peuple habile dans l'usage de sa féminité. Elle tourne, entre 1955 et 1994, une quinzaine de films avec Mastroianni, dont Une journée particulière (1977) d'Ettore Scola, où le « couple d'or du cinéma italien » est totalement revisité.
Le cinéma italien par le prisme de ses vedettes : Marcello Mastroianni et Sophia Loren
Conférences avec vidéoprojection
10 jeudis de 9h45 à 12h15
début le 29.01.2026
234 € (3x78)